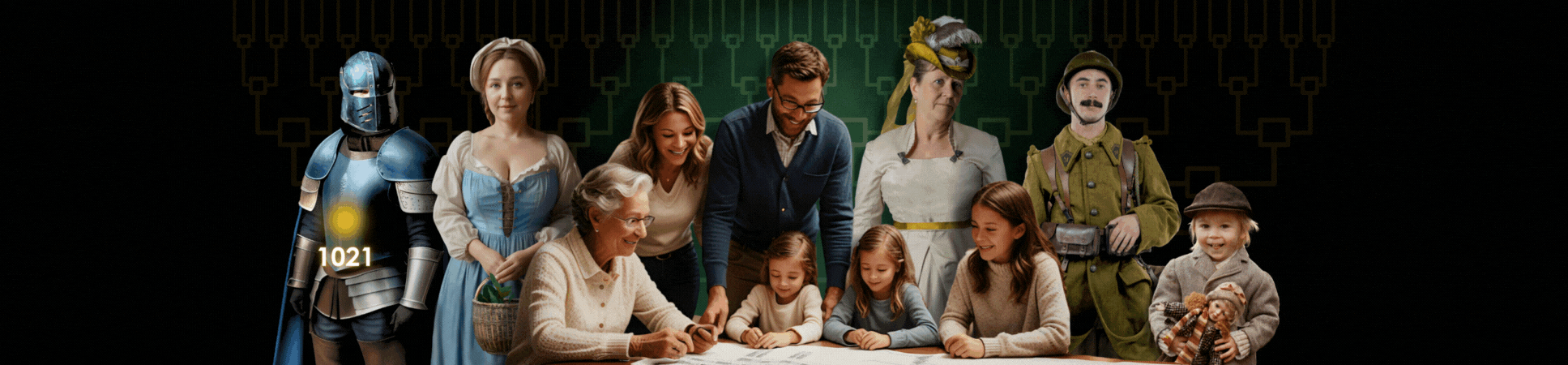articles, tutoriel et informations autour de généatique et de la généalogie

Quand nos ancêtres nous racontent le climat
Envie de comprendre comment le climat a sculpté la vie de vos ancêtres ? Notre article révèle comment la généalogie permet de débusquer les traces d’hivers redoutables, de sécheresses et d’inondations dans les archives. Découvrez la résilience de vos aïeux face aux famines et épidémies liées aux intempéries , et explorez une facette insoupçonnée de leur quotidien. Existe-t-il une mémoire climatique de votre famille ?

Les soldes d’été ont commencé très fort !
N’attendez pas pour profiter des soldes d’été de Généatique …

La Généalogie Successorale : histoires d’héritages Oubliés
Un héritage inattendu ou une succession bloquée ? Découvrez comment les généalogistes successoraux dénouent ces mystères et reconnectent les familles à leur patrimoine.

Débloquez tout le potentiel de votre généalogie avec les services Généatique
Quelques informations sur les formules de services Généatique, les 3 niveaux, la multitudes de services…
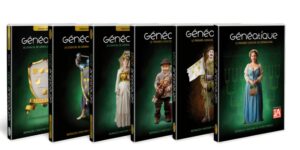
Pourquoi Mettre à Jour Votre Logiciel Généatique ?
Donnez un coup de jeune à votre généalogie : découvrez comment mettre à jour votre logiciel Généatique va transformer vos recherches, les rendre plus sûres et encore plus passionnantes !
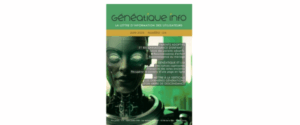
Sommaire Généatique Info n° 104
Retrouvez ici le sommaire détaillé du Généatique Info n°104.
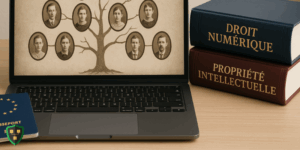
Les Aspects Légaux et Éthiques de la Généalogie Numérique
La généalogie numérique, là où la découverte de nos racines croise des enjeux légaux et éthiques majeurs. Confidentialité des données, droits d’auteur sur les archives, et implications des tests ADN : autant de sujets cruciaux pour explorer le passé avec responsabilité.

Conférence 27/05/2025 : archives hospitalières
Marine Leclercq Bernard ne pourra pas assurer la conférence prévue sur les archives hospitalières.
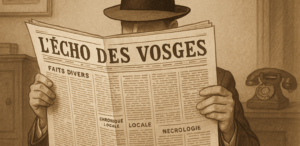
La presse ancienne, un trésor oublié
Vos ancêtres n’étaient peut-être pas des stars, mais ils apparaissaient peut-être dans… la presse ! Anne-Noëlle nous explique comment retrouver tout cela…

Astuce : revenir au SOSA 1 en 2 clics sur mon arbre généalogique
Une autre astuce indispensable pour le mois de la généalogie…
Comment revenir le plus vite possible et sans erreur au début de votre arbre généalogique ? En 2 clics !

Astuce : ajouter un champ dans l’écran de saisie
Comment faire pour ajouter un champ de saisie sur votre écran ?

Remise sur les impressions
Nous vous rappelons qu’à l’occasion du Mois de la Généalogie (le mois de Mai, comme chaque année), vous pouvez profiter d’une belle remise sur les impressions de grands arbres et les impressions de vos livres de généalogie avec Généatique. Lancez votre commande à partir du logiciel Généatique 2025, validez le devis…

Astuce : passer de fiche en fiche dans une liste
Cette astuce là change la vie du généalogiste amateur…

Astuce : ajouter les images des actes trouvés sur Internet sur mes fiches
Et voici une autre petite astuce Généatique, toujours dans le cadre du mois de la généalogie… Savez-vous intégrer directement dans vos fiches les images trouvées sur la fenêtre Internet de Généatique ? Pour tout savoir, voici une petite vidéo de 3 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=KrgXRdbFGm4

Quand l’Ancien Régime notait les grossesses hors-mariage
Entre les XVIe et XIXe siècles, des femmes enceintes non mariées allaient déclarer leur grossesse… au juge, au greffier ou au notaire. Pourquoi ? Pour ne pas être accusées d’infanticide si leur bébé mourait sans avoir été baptisé. Et ces déclarations, aussi surprenantes que touchantes, recèlent aujourd’hui des trésors pour les généalogistes. Exploration d’une pratique oubliée qui en dit long sur nos ancêtres… et leurs amours contrariées.

Astuce : rechercher une personne à travers les sites Internet de Généalogie
Pour le mois de la généalogie, j’essaie de vous montrer de petites astuces pour l’utilisation de Généatique…
C’est modeste, mais je vous assure que je connais des personnes qui ne savent pas encore faire !

Astuce : rechercher une personne à travers tous les sites Internet de Généalogie
Une petite astuce avec de grande

Résistance et Collaboration dans nos arbres généalogiques
La Seconde Guerre mondiale a gravé des sillons ineffaçables dans le paysage européen, et les familles portent encore aujourd’hui les stigmates de cette période tumultueuse. Si l’histoire officielle retient les noms des grandes figures de la Résistance et de la Collaboration, qu’en est-il de nos aïeux ?

Les mystères des enfants trouvés
Les enfants trouvés sont comme des fantômes du passé : leur histoire est fragmentaire, leur identité incertaine, et leur place dans l’arbre familial ressemble souvent à une case vide.

Le rôle essentiel des associations de généalogie
Un généalogiste n’a jamais trop de sources d’informations pour en apprendre plus sur ses ancêtres…